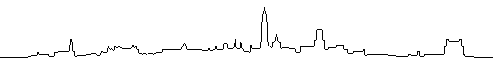| |
TU5EX > ESPACE 19.10.06 22:34l 259 Lines 14183 Bytes #999 (0) @ FRANCA
BID : JAGTU5EX_0MD
Read: GUEST
Subj: La Galaxie d'Andromède
Path: ON0AR<HS1LMV<TU5EX
Sent: 061019/2134z @:TU5EX.FPCA.FRA.EU [Claviers JN33HO] obcm1.07
From: TU5EX @ TU5EX.FPCA.FRA.EU (Didier)
To: ESPACE @ FRANCA
X-Info: Sent with login password
X-Info: Received by SMTP-gateway
La Galaxie d'Andromède
[m31.jpg]
Ascension Droite Déclinaison Distance Magnitude Dimension
00h42m.7
+41°16'
2 900 kilo.al
3,4 (vis)
178'x63'
Connue de Al-Sufy aux environs de l'an 905 de notre ère.
M31 est la fameuse Galaxie d'Andromède, notre plus proche grande
voisine, formant le Groupe Local de galaxies, avec ses compagnons
(comprenant M32 et M110, deux brillantes naines elliptiques), notre Voie
Lactée et ses propres compagnons, puis M33 et plusieurs autres.
Visible à l'il nu même dans des conditions médiocres d'observation, cet
objet était connu de l'astronome persan Abd-al-Rahman Al-Sufi, comme le
"petit nuage" qu'il décrivit et représenta en 964 dans son Livre des
Etoiles Fixes : Elle était probablement largement connue et observée par
les astronomes persans à Ispahan dès 905 de notre ère, ou même avant.
R.H. Allen (1899/1963) indique qu'elle était déjà portée sur une carte
céleste hollandaise en 1500. Charles Messier, qui l'entra dans son
catalogue le 3 Août 1764, ignorait évidemment cette antériorité et
attribuait la découverte à Simon Marius, qui fut le premier à en donner
une description télescopique en 1612, mais (selon R.H. Allen) ne
revendiqua pas l'antériorité. Ne connaissant ni la découverte de Al Sufy
ni celle de Marius, Giovanni Batista Hodierna redécouvrit
personnellement cet objet avant 1654. Cependant Edmond Halley, dans son
Traité des Nébuleuses de 1716, attribue la découverte à l'astronome
français Bullialdus (Ismail Bouillaud), qui l'observa en 1661 ; mais ce
dernier indique qu'il avait déjà été vu 150 ans plus tôt (au début des
années1500) par quelque astronome anonyme (R.H. Allen, 1899/1963).
On crut pendant longtemps que la "Grande Nébuleuse d'Andromède" était
l'une des plus proches nébuleuses. William Herschel pensait, à tort
évidemment, que sa distance "ne devait pas excéder 2 000 fois la
distance de Sirius" (soit 17 000 années-lumière) ; néanmoins, il voyait
en elle le plus proche "univers-île", identique à notre Voie Lactée,
qu'il pensait être un disque d'un diamètre égal à 850 fois la distance
de Sirius et d'une épaisseur de 155 fois cette même distance.
Ce fut William Huggins, le pionnier de la spectroscopie, qui remarqua en
1864 la différence entre nébuleuses gazeuses, avec leurs propres lignes
spectrales, et ces "nébuleuses" au spectre continu, de type stellaire,
que nous savons maintenant être des galaxies, et qui justement découvrit
le spectre continu de M31 (Huggins and Miller 1864).
En 1887, Isaac Roberts réalisa les premiers clichés photographiques de
la "nébuleuse" d'Andromède, faisant apparaître pour la première fois les
traits caractéristiques d'une structure spirale.
En 1912, V.M. Slipher du Lowell Observatory mesura sa vitesse radiale
qui se trouva être la vitesse la plus élevée jamais mesurée, environ 300
km/sec dans notre direction. Ceci était déjà une indication de la nature
extra-galactique de l'objet. (selon Burnham le chiffre de 266 km/sec
serait plus juste, mais R. Brent Tully donne 298 km/sec et le NED a de
nouveau présenté 300 +/- 4 km/s comme valeur actualisée). Il faut noter
que toutes ces valeurs décrivent le mouvement par rapport à notre
Système Solaire, c'est à dire un mouvement héliocentrique, et non par
rapport au Centre Galactique (de la Voie Lactée). Cette dernière valeur
peut être obtenue en tenant compte du mouvement de notre Système Solaire
autour de ce centre. Les valeurs actuelles concernant la vitesse de
rotation galactique et la vitesse radiale héliocentrique indiquent que
la Galaxie d'Andromède et la Voie Lactée s'approchent l'une de l'autre à
environ 100 km/sec.
En 1923, Edwin Hubble découvrit la première variable Céphéide dans la
galaxie d'Andromède, déterminant ainsi la distance intergalactique et la
vraie nature de M31 en tant que galaxie. Mais comme il ne savait pas
qu'il existait deux types de Céphéides, la distance s'en est trouvée
erronée d'un facteur de plus de deux. Cette erreur passa inaperçue
jusqu'en 1953, époque de mise en service du télescope de 200-inch (5
mètres) du Mont-Palomar. Hubble publia en 1929 son étude historique
présentant la "nébuleuse" d'Andromède comme un système stellaire
extragalactique (galaxie) (Hubble 1929).
A notre époque Andromède est certainement la galaxie "externe" la plus
observée. C'est particulièrement intéressant car cela permet l'étude des
caractéristiques d'une galaxie vue de l'extérieur, caractéristiques qui
sont aussi celles de la Voie Lactée mais que l'on ne peut pas voir
puisque la plus grande partie de notre galaxie est cachée par la
poussière interstellaire. C'est pourquoi on poursuit en permanence
l'étude de la structure spirale, des amas ouverts et globulaires, de la
matière interstellaire, des nébuleuses planétaires, des restes de
Supernova (voir l'article de Jeff Kanipe dans la revue Astronomy de
Novembre 1995 page 46), du noyau galactique, de ses galaxies satellites
et de bien d'autres choses encore.
Plusieurs des points ci-dessus méritent l'attention des amateurs : même
Charles Messier trouva ses deux brillants compagnons, M32 et M110,
visibles aux jumelles, remarquables dans un petit télescope et fit un
dessin des trois.
Ces deux compagnons relativement proches et brillants sont visibles sur
de nombreuses photos de M31, dont celle de cette page. Ils sont
seulement les plus brillants d'un "essaim" de plusieurs autres plus
petits qui entourent Andromède et forment un sous-groupe du Groupe
Local. A l'époque de la rédaction de ces lignes (Septembre 2003), au
moins 11 d'entre eux sont connus : en plus de M32 et M110 on trouve NGC
185, découvert par William Herschel, et NGC 147 (découvert par d'Arrest)
ainsi que les très diffus systèmes nains And I, And II, And III et
éventuellement And IV (qui pourrait cependant être un amas ou une
galaxie distante en arrière-plan), And V, And VI (également appelé
"Pegasus dwarf"), And VII (Cassiopeia dwarf) et And VIII. Il n'est
toujours pas certain que M33, la petite galaxie spirale du Triangle, et
son compagnon probable LGS 3, appartiennent à ce sous-groupe, ou au plus
lointain membre du Groupe Local IC 1613, ou encore à l'un de ces membres
possibles que sont UGCA 86 ou UGCA 92.
La Galaxie d'Andromède est en notable interaction avec son compagnon
M32, lequel est apparemment responsable de la quantité considérable de
déformations de la structure spirale. Les bras d'hydrogène neutre sont
séparés de 4 000 années-lumière de ceux composés d'étoiles, et ne
peuvent pas être observés en continu dans la zone la plus proche du
petit voisin. Les simulations sur ordinateurs ont montré que les
perturbations peuvent être modélisées en considérant le passage
rapproché récent d'un petit compagnon de la masse de M32. Ce dernier,
très probablement, a aussi souffert de cette rencontre en perdant de
nombreuses étoiles, aujourd'hui disséminées dans le halo d'Andromède.
Le plus brillant des amas globulaires de la Galaxie d'Andromède, G1, est
aussi le plus lumineux du Groupe Local de Galaxies ; sa magnitude
visuelle apparente depuis la Terre est d'environ 13,72. Il surpasse
ainsi le plus brillant amas globulaire de la Voie Lactée, Oméga
Centauri, et peut même être entrevu par les amateurs bien équipés, dans
des conditions très favorables d'observation, avec des télescopes d'au
moins 10 pouces (25 cm) d'ouverture (voir l'article de Leos Ondra dans
Sky & Telescope de Novembre 1995, p. 68-69). Le Télescope Spatial Hubble
a été utilisé pour explorer l'amas globulaire G1 à la mi-1994
(publication en Avril 1996). Bien que le plus facile, G1 n'est pas le
seul amas globulaire de M31 à être à portée des grands télescopes
d'amateurs : ainsi Steve Gottlieb a pu observer 18 amas globulaires avec
un instrument de 44cm. Avec leur 14 pouces (36 cm) Newton et une caméra
CCD CB245, les observateurs du "Ferguson Observatory", près de Kenwood
en Californie, ont pu photographier G1 et quatre faibles amas
globulaires de M31. De leur côté Barmby et.al (1999) ont trouvé 435
candidats amas globulaires, et estiment le nombre total à 450 +/- 100.
Ici encore l'astrophotographe est avantagé car il peut collecter la
moindre lumière des fins détails des bras spiraux, que l'on distingue
très bien sur notre illustration : les amateurs peuvent ainsi obtenir
des images saisissantes, même avec un équipement modeste, depuis le
grand-angle jusqu'à la vue rapprochée et détaillée. Mais en photographie
aussi, un meilleur équipement est toujours payant, comme le prouve
l'Amateur Texan Jason Ware, auteur de la photo ci-dessus réalisée avec
une lunette de 6 pouces (15 cm) et reproduite avec son autorisation. De
plus amples informations sont disponibles à propos de cette image.
Le plus brillant nuage d'étoiles de la galaxie d'Andromède M31 a reçu
son propre numéro NGC, soit NGC 206, parce que William Herschel l'avait
noté dans son catalogue comme H V.36 sur la base de son observation et
de sa découverte le 17 Octobre 1786. C'est le brillant nuage d'étoiles
dans le haut gauche de notre image (très bien visible sur la photo
agrandie), juste sous une remarquable nébuleuse obscure.
Malgré la masse de connaissances accumulées aujourd'hui sur la Galaxie
d'Andromède, sa distance n'est pas réellement bien déterminée, même si
elle est parmi les mieux connues au niveau intergalactique. En effet,
s'il est bien établi que M31 est environ 15 à 16 fois plus éloignée que
le Grand Nuage de Magellan (LMC), la valeur absolue de cette mesure
reste encore incertaine, habituellement donnée entre 2,4 et 2,9 millions
d'années-lumière. Ceci est une conséquence de l'incertitude sur la
distance du LMC ainsi que sur l'échelle générale des distances
intergalactiques. C'est ainsi que la (relativement) récente correction,
à partir des données recueillies par le satellite astrométrique
Hipparcos de l'ESA, a augmenté cette valeur de plus de 10 %, soit de 2,4
à 2,5 à environ 2,9 millions d'années-lumière que nous utilisons ici.
Dans des conditions "normales" d'observation, les dimensions angulaires
apparentes de la Galaxie d'Andromède sont d'environ 3x1 degrés (notre
valeur plus précise, donnée ci-dessus, est de 178x63 minutes d'arc et,
de son côté, le NED indique 190x60. De soigneuses estimations de son
diamètre angulaire, obtenues avec des jumelles de 50mm, par l'astronome
français Robert Jonckhere en 1952-1953, aboutissent à un développement
en degrés de 5,2x1,1 (rapporté par Mallas), correspondant à un disque de
plus de 250 000 années-lumière à une distance de 2,9 million AL, de
sorte que cette galaxie est environ deux fois plus large que notre Voie
Lactée !
L'estimation de sa masse est de 300 à 400 milliards de fois celle du
Soleil. Comparé aux dernières estimations concernant la Voie Lactée,
cela est considérablement moins que la masse de notre galaxie,
impliquant que celle-ci doit être beaucoup plus dense que M31. Ces
résultats sont confirmés par les nouvelles estimations de la masse
totale de leur halo respectif, qui se révèle être d'environ 1,23
trillion (10^12) de masses solaires pour M31 et de 1,9 trillion (10^12)
pour la Voie Lactée (Evans and Wilkinson, 2000).
Le Télescope Spatial Hubble a révélé que la Galaxie d'Andromède M31
possédait un noyau double. Ceci laisse penser que, soit elle a
réellement deux noyaux brillants, probablement parce qu'elle a "absorbé"
une plus petite galaxie qui un jour a pénétré dans son environnement,
soit des parties de son noyau unique sont obscurcies par de la matière
sombre, probablement de la poussière. Dans le premier cas le noyau
supplémentaire peut être un reste d'une violente collision, évènement
dynamique survenu dans les premiers temps de l'histoire du Groupe Local.
Dans le deuxième cas le dédoublement du noyau d'Andromède serait une
illusion causée par un nuage sombre l'occultant partiellement.
A ce jour une seule supernova a été observée dans la Galaxie
d'Andromède, celle de 1885, également appelée S Andromedae. Ce fut la
première supernova découverte hors de la Voie Lactée le 20 Août 1885 par
Ernst Hartwig (1851-1923) à l'Observatoire de Dorpat en Estonie. Elle
atteignit la magnitude 6 entre le 17 et le 20 et fut signalée
indépendamment par plusieurs observateurs. Cependant, seul Hartwig eut
la pleine compréhension de cette découverte. Sa brillance diminua pour
atteindre la magnitude 16 en février 1890.
# Historique des Observations et Descriptions de M31
# Images de M31 par le "Isaac Newton Telescope", prises par les
astronomes du INT et David Malin
# Autres images de M31
# Images Amateur de M31
# Observations de M31 par IRAS en lumière infrarouge
# Observations de M31 par Rosat en rayonnement X
# Images de M31 par Chandra (X-ray Observatory)
# Images GALEX de M31 en rayonnement ultraviolet
# Autres images de M31 et M32
# Images Amateur de M31 et M32
Animation expliquant la structure de M31
Liens
* Atlas de la Galaxie d'Andromède par Paul W. Hodge. University of
Washington Press, 1981.
* DIRECT: Un projet en vue d'établir directement les distances de
M31 et M33 (par Kris Stanek, Harvard-Smithsonian CfA)
* Atlas de M31 par John A. Blackwell
* Page M31 de Jack Schmidling
* Collection d'images multispectrales de M31, SIRTF Multiwavelength
Messier Museum
* Données sur M31 (SIMBAD)
* Données sur M31 (NED)
* Rapports d'observations pour M31 (IAAC Netastrocatalog)
Références
* P. Barmby, J.P. Huchra, J.P. Brodie, D.A. Forbes, L.L. Schroeder
and C.J. Grillmair, 1999. Preprint astro-ph/9911152.
* N.W. Evans and M.I. Wilkinson, 2000. The mass of the Andromeda
galaxy. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 316,
Issue 4, p. 929-942 (08/2000)
* Edwin P. Hubble, 1929. Astrophysical Journal, Vol. 69, p. 103-157
and plates III-VIII.
* William Huggins and W.A. Miller, 1864. On the Specta of some of
the Nebulae. Philosophical Transactions, Vol. 154 (1864), p. 437.
source: Observatoire de Meudon
www.tu5ex.org
Read previous mail | Read next mail
| |